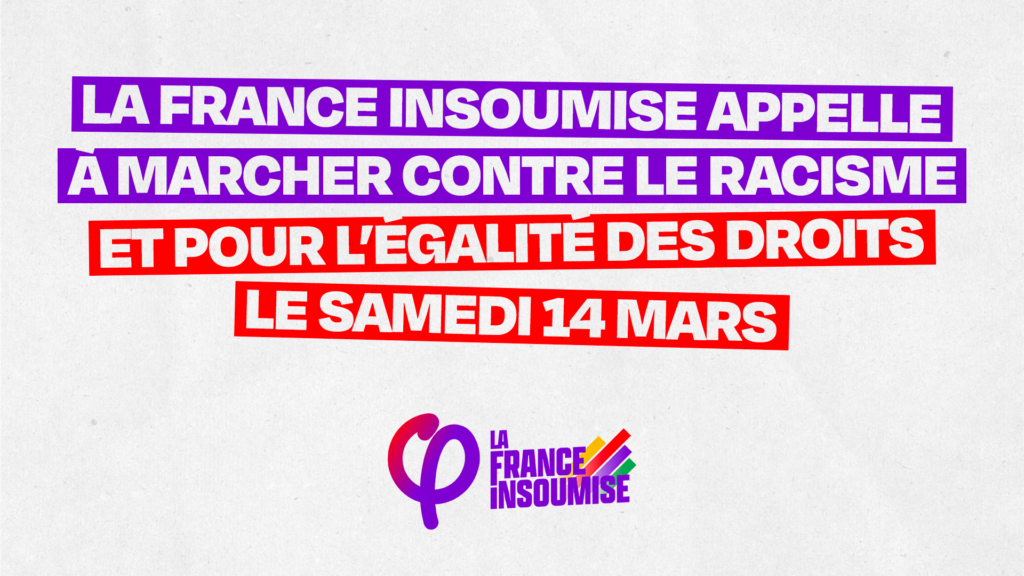Article de Nicolas Demian publié initialement dans l’Heure du Peuple le 17 septembre 2018 (voir ici)
Il y a dix ans, le 15 septembre 2008, la faillite de la banque américaine Lehman Brothers marquait un nouveau tournant dramatique dans la crise des subprimes débutée presque un an auparavant. Les subprimes, ce sont ces prêts hypothécaires accordés à des ménages américains pauvres et insolvables, qui furent titrisés par les marchés financiers pour les vendre en paquet et les disséminer dans l’ensemble des réseaux financiers de la planète. Dans un système monétaire et financier où la création monétaire par le crédit repose malheureusement uniquement sur la solvabilité de l’emprunteur, prêter à des personnes insolvables est risqué. Mais pour les marchés financiers, le risque entraîne le rendement : plus il est important, plus on peut gagner d’argent.
Lorsque les prix de l’immobilier se retournèrent, la crise financière éclata. Elle devint rapidement une crise bancaire, et donc une crise monétaire. L’investissement massif des banques, d’affaires comme de dépôts, sur les marchés financiers, montra plus que jamais ses effets nocifs. En effet, plus les banques sont devenues gigantesques, présentant des bilans de plusieurs centaines ou milliers de milliards d’euros (composés de toujours plus de produits financiers et de toujours moins de crédits aux particuliers ou aux entreprises), plus elles sont devenues fragiles et vulnérables aux fluctuations irrationnelles des marchés financiers.
La situation est d’autant plus compliquée que les produits financiers ne sont ni suffisamment régulés ni suffisamment standardisés pour que l’on sache véritablement ce qu’ils contiennent et quelle est leur valeur, sans parler bien sûr de leur utilité sociale. En 2008, les banques se sont ainsi retrouvées avec d’importants montants d’actifs financiers pourris, dont elles étaient par ailleurs incapables d’évaluer la valeur réelle. La défiance s’est alors répandue comme une traînée de poudre dans les milieux financiers. La crise bancaire s’est traduite par une crise d’illiquidités, car les banques ne se prêtaient plus entre elles les liquidités dont elles avaient besoin pour solder leurs positions sur le marché interbancaire. Arrivés à ce point, l’effondrement du système était proche. La monnaie et le crédit, ces deux faces du même bien commun, se retrouvèrent menacés de disparition.
Une réponse qui ne change rien au fond
Face au danger, les banques centrales ont réagi en baissant au maximum les taux d’intérêt et en inondant les banques commerciales de liquidités. Elles les leur fournissent en leur rachetant les actifs démonétisés dont ces banques commerciales n’arrivent plus à se défaire. Cette décision sauvera les banques et le système monétaire. C’était indispensable. Mais c’était loin d’être suffisant pour qui mesure la tragédie sociale engendrée par cette crise. Seules quelques banques d’affaires, comme Lehman Brothers, firent faillite, tandis que d’autres furent rachetées à bas prix par leurs concurrents. Pour les autres, l’aléa moral est maximum : elles n’assumeront pas la responsabilité de leurs actes, qui sera toute entière endossée par les banques centrales et par les Etats. Car pour les sauver, la banque centrale n’a pas agi seule : les Etats ont également dû mettre à disposition des sommes colossales, se comptant en centaines de milliards d’euros, sous forme de prêts disposant de garanties publiques ou de prises de participation.
C’est à la lumière de ces événements que l’on remarque avec effarement la colossale prise d’otages des banques privées sur la monnaie et les moyens de paiement, et par conséquent sur la société toute entière. Privatisation des profits et socialisation des pertes, qui se traduit aujourd’hui encore par les milliers de milliards d’euros de titres financiers pourris détenus par les banques centrales, et qui ne seront jamais revendus sur le marché. Les banques centrales ont ainsi fait tourner la planche à billet au maximum, mais uniquement pour sauver les banques, tandis que les Etats, faute de contrôler l’arme monétaire, plient sous les plans d’austérité.
Ceux-ci avaient pourtant tous les leviers économiques et politiques pour imposer des réformes drastiques du système financier et monétaire. Ils pouvaient, par exemple, nationaliser et fusionner des banques privées pour créer un grand pôle public bancaire qui permettrait de créer de la monnaie dans l’intérêt général, comme le propose L’avenir en commun, le programme de la France insoumise. Sans même aller jusque-là, ils pouvaient profiter de l’occasion pour séparer réellement banques d’affaires et banques de dépôt, afin de protéger l’épargne et la fonction de crédit des errements des activités spéculatrices des banques (qui constituent plus de la moitié de leur bilan). La loi Moscovici de 2013 n’en fait rien, et ne sépare que moins de 1% des activités spéculatives. Il aurait encore été possible de ralentir les flux de capitaux spéculatifs en introduisant des obligations minimales de durée de placement et une modulation des droits de vote en fonction de la durée d’investissement. Les Gouvernements auraient pu, enfin, chercher à refonder le lien entre les banques centrales et les Etats, en rétablissant les avances des premières aux seconds à des taux, dans des montants et pour des durées qui leur permettent de relancer réellement l’activité, notamment autour de critères écologiques. Les solutions techniques ne manquent pas pour réduire la fréquence et la gravité des crises et orienter la masse monétaire vers des activités socialement utiles.
Mais la volonté de les mettre en œuvre n’a jamais traversé l’esprit des gouvernements qui se sont succédé depuis 2008. L’Union bancaire qu’ils tentent péniblement de construire au sein de la zone euro n’emporte aucune réforme décisive : elle harmonise tout au plus les règles de supervision et crée un mécanisme de résolution unique (des crises bancaires), dont les 55 milliards d’euros de dotation apparaissent bien faibles. Il serait emporté comme un feu de paille à la première tempête financière secouant sérieusement une ou plusieurs banques systémiques (le bilan de la seule Société générale est, par exemple, de 1 300 milliards d’euros en 2018). Seule avancée, les exigences de fonds propres ont été légèrement renforcées, à hauteur de 8% dans les accords de Bâle 3, contre 4% dans les accords de Bâle 1. Mais on demeure très loin des enjeux.
Depuis dix ans, peu a donc été fait en matière de régulation financière et de reprise en main du système monétaire, mais beaucoup a été fait pour renouer avec les pratiques qui nous ont conduit à la crise : la titrisation redevient une pratique courante ; la dette privée explose (130% du PIB en France contre 98% pour la dette publique) ; le marché des changes et les flux de capitaux sont toujours aussi volatils ; et l’indépendance des banques centrales les condamnent trop souvent à l’impuissance. Face à cela, il est urgent de changer de système et de donner à la monnaie ce rôle d’émancipation qui pourrait être le sien, au service de l’intérêt général.
Nicolas Demian