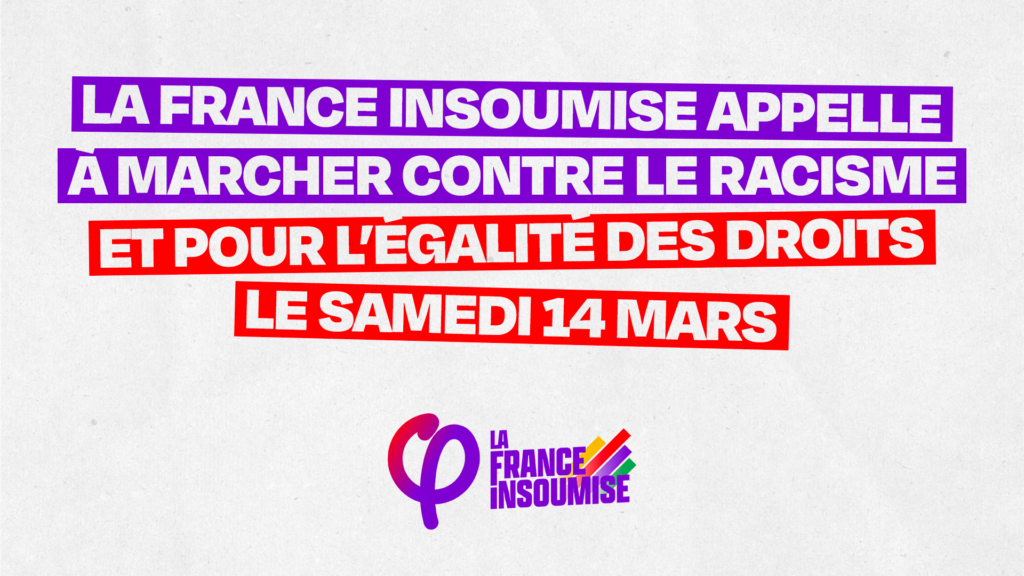Un article du groupe thématique Droits nouveaux & LGBTI
La proposition de loi (PPL) visant à réformer l’adoption, déposée par le groupe LREM à l’Assemblée nationale, a été examinée en première lecture les 2 et 4 décembre dernier. Cette proposition de loi fait suite au rapport parlementaire sur l’adoption présenté en octobre 2019 par la députée Monique Limon et la sénatrice Corinne Imbert.
L’adoption est finalement un phénomène assez mal connu. Elle sert d’abord à donner une famille à un ou une enfant qui l’a perdu. Outre-mer, elle sert aussi à organiser les placements et les dons d’enfants, selon la coutume comme en Calédonie (avec le droit coutumier local) ou selon le Code civil comme en Polynésie française (avec dans ce dernier cas plus ou moins de réussite, notre Code civil n’étant pas lié à une conception universelle de la famille, si une telle chose existe, mais une conception qui ne dépasse pas les limites de la culture qui l’a produite). Un dernier usage est beaucoup moins connu : quand l’adoption sert à traduire en droit une situation de fait. Il ne s’agit alors pas de faire venir une ou un enfant étranger dans une famille, car l’enfant y est déjà. C’est le cas lorsqu’un beau-parent souhaite adopter l’enfant de son époux ou de son épouse (cette dernière pratique est la seule qui permet actuellement à la mère n’ayant pas accouché dans un couple de femmes de se voir reconnue comme deuxième mère légale).
On entend assez souvent, comme un fait communément admis, qu’il y aurait « plein d’enfants malheureux qui n’attendent que d’être adoptés ». Alors qu’en réalité, l’adoption nationale concerne chaque année un chiffre assez stable : environ 800 enfants français·es adopté·es par an. Et pourtant l’ASE (Aide sociale à l’enfance, qui était, avant la loi de décentralisation de 1983, gérée par la DDASS) prend en charge environ 300 000 mineur·es (soit un taux de prise en charge de 20 ‰ des moins de 18 ans), dont environ 138 000 sont placé·es en familles d’accueil ou établissements (chiffres de 2016). Pourtant, bien peu sont considérés comme adoptables (il n’y a qu’environ 2 400 pupilles de l’État, donc, en théorie, adoptables).
Il y a donc une énorme différence entre le nombre d’enfants où une adoption permettrait d’arrêter de les ballotter de foyers en familles d’accueil et de les stabiliser dans un foyer aimant, et le nombre d’enfants qui peuvent concrètement être adopté·es. La loi du 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfance, avait créé la procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental : une timide avancée pour sortir de la « carte d’anniversaire envoyée chaque année », qui était le prétexte de bien des juges pour ne pas déclarer délaissé·es des enfants, les condamnant à être inadoptables jusqu’à leurs 18 ans.
Par rapport à cette réalité, la PPL entend faciliter l’adoptabilité des enfants, mais sans s’attaquer de front au problème. Elle renvoie la balle au gouvernement, en l’autorisant à légiférer par ordonnance « dans un délai de 8 mois », « en matière d’adoption, de déclaration judiciaire de délaissement parental, de tutelle des pupilles de l’État et de tutelle des mineurs ».
Elle comporte surtout :
- L’ouverture de l’adoption aux couples non mariés (le couple marié n’étant plus depuis longtemps la référence unique de la famille, un des derniers privilèges du mariage tombe).
- La création d’un dispositif transitoire (3 ans après l’adoption de la prochaine révision de la loi bioéthique) pour permettre à la mère qui n’a pas accouché, dans les couples de femmes qui ont eu un enfant par PMA à l’étranger avant la future adoption de la loi bioéthique et qui se sont séparées avant d’organiser l’adoption de l’enfant du conjoint (puisqu’il leur faut, actuellement, être non seulement en couple mais mariées), d’adopter son enfant. L’éventuel refus de la mère légale (celle qui a accouché) pourrait être outrepassé par le tribunal si c’est dans l’intérêt des enfants. Notre groupe à l’Assemblée a proposé un amendement, malheureusement rejeté, pour étendre ce dispositif : qu’il ne soit pas transitoire et lié au seul parcours de la PMA médicalisée (des couples de femmes continueront de se rendre à l’étranger après l’ouverture de la PMA en France, ou continueront à utiliser des méthodes plus artisanales) et non restreint aux seuls couples de femmes (il y a des situations de beau-parentalité dans les couples hétérosexués qui pourraient bénéficier d’un tel dispositif — ce qui montre encore une fois que des réformes pour des cas particuliers peuvent profiter à l’ensemble de la société, comme le pacs, utilisé aujourd’hui à plus 95 % par des couples hétérosexués).
- La modification de l’organisation et du fonctionnement des conseils de famille, qui ont à se prononcer sur l’adoption. L’idée est, entre autres, de prévenir la mise à l’écart systématique des couples homosexués (en 2018, moins de 1 % de l’ensemble des adoptants étaient des couples de même sexe, selon des chiffres du ministère de la Justice rendus publics en septembre dernier). C’est louable, mais ce sera probablement assez peu efficace. Notre groupe a proposé la création d’un rapport à ce sujet, proposition qui fut rejetée.
En somme, cette PPL s’inscrit dans l’orientation générale qui avait déjà cours sous François Hollande : accompagner le progrès des mœurs sans bouleverser l’ordre social, sans trop changer, en restant « raisonnable » et, en même temps, « moderne ».
Ainsi, comme la loi mariage de 2013, comme la loi de modernisation de la justice de 2016, comme la loi bioéthique actuellement en discussion, cette réforme comporte certes des avancées, mais qui s’arrêtent au milieu du gué.