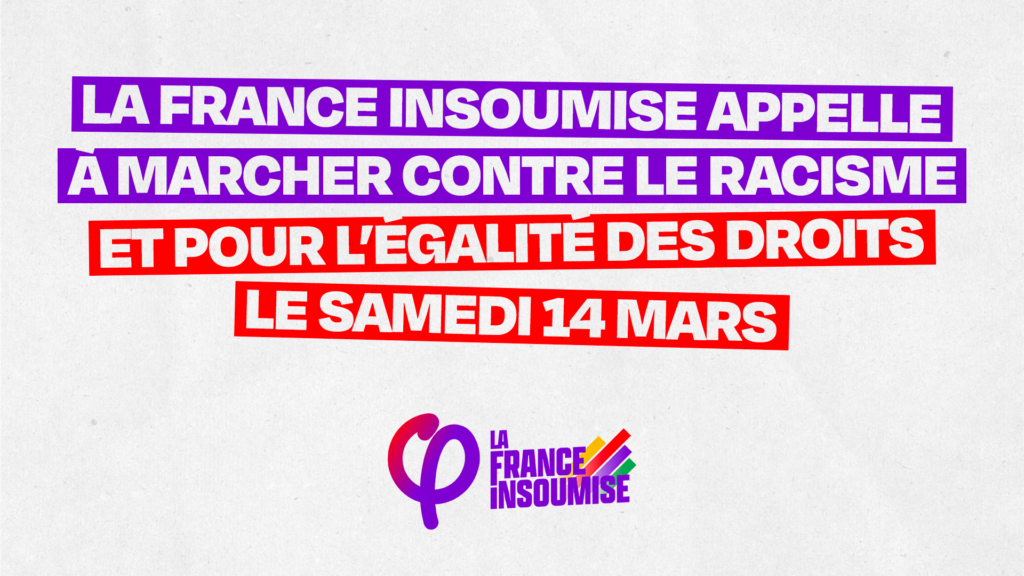Le groupe parlementaire de la France insoumise a la possibilité d’initier la création d’une commission d’enquête une fois par session, par le biais de ce qui est appelé « droit de tirage. » Nous avons décidé de consacrer notre toute première commission d’enquête à la question de l’alimentation industrielle, sujet auquel personne ne peut échapper, avec une préoccupation constante : comment reprendre le pouvoir sur son assiette ? La présidence de cette commission revenant de droit à un-e insoumis-e, le groupe parlementaire FI m’a proposé cette fonction. J’ai donc la charge d’en mener les travaux qui déboucheront sur un rapport et des propositions concrètes à la fin du mois de septembre. En attendant, je me permets de vous en proposer un condensé en plusieurs parties.
Ce premier volet fait un retour sur les différentes auditions des scientifiques et universitaires.
Une large partie des débuts de nos travaux ont été consacrés à questionner des scientifiques. Moment qui, s’il peut paraitre fastidieux car révélateur de nombres d’éléments techniques à défricher, digérer et articuler, n’en est pas moins indispensable pour constituer une base solide qui nous servira de boussole pour la suite des auditions. Bien sûr, nous avons convié beaucoup de spécialistes des sciences dites « dures », biologistes, chimistes, agronomes, épidémiologistes, etc. Mais nous avons voulu élargir ce champ aux sciences sociales avec des économistes, des géographes pour croiser les regards et les méthodes.
D’abord des constats précis, tranchants, étayés et partagés par la communauté scientifique. Le surpoids et l’obésité touchent plus de la moitié de la population adulte française et 17 % des enfants. Chez les adultes, la seule obésité touche presque 1 individu sur 5. Son coût social est évalué à plus de 20 milliards d’euros, supérieur à celui de l’alcool ! C’était à craindre, elle est davantage présente chez les catégories populaires, dans les ménages où le capital économique et culturel est le moins élevé. Ceux qui, proportionnellement à leur revenu, ont des dépenses alimentaires plus élevées : 25 % du budget des 20 % des ménages les moins favorisés contre 15 % en moyenne pour tous les ménages.
Ce sont également les classes populaires qui sont les plus exposées au marketing agressif des grandes firmes agroalimentaires comme de la distribution, qui s’approprient à peu de frais et à grand renfort de mauvaise foi la propriété du « combat pour le pouvoir d’achat. » Ce que déplore le géographe, enseignant à Paris IV, Gilles Fumey, quand il décrit le patron éponyme des magasins Leclerc comme un « prêtre » jouant un « rôle qu’on ne lui a pas demandé de tenir. »
Nous subissons directement les conséquences sanitaires d’un système devenu absurde. Les professeurs Serge Hercberg et Mathilde Touvier ont mis en évidence la relation de cause à effet suivante : une augmentation de 10 % des produits ultra-transformés dans le régime alimentaire augmente de 11 à 12 % le risque de cancers, plus encore si l’on s’intéresse au seul cancer du sein. Or, ces produits ultra-transformés représentent l’écrasante majorité de l’offre alimentaire en supermarché. Anthony Fardet, chercheur à l’INRA Grenoble en propose la définition suivante, s’appuyant sur des travaux menés par des scientifiques brésiliens à partir des années 1980 : « des aliments caractérisés dans leur formulation par l’ajout d’au moins un ingrédient ou additif cosmétique à usage industriel pour imiter, exacerber ou restaurer des propriétés sensorielles – textures, goût, couleur. » En pratique, il s’agit souvent de produits littéralement fabriqués de toutes pièces : confiseries, soda, nuggets, etc. À partir de moins d’un millier de produits de base, les industriels fabriquent plus de 500 000 produits !
D’autres substances que les additifs, appliqués beaucoup plus en amont de la production, sont également dangereuses. C’est le sens de l’alerte donnée il y a quelques mois par plusieurs chercheurs, dont Pierre Rustin, directeur de recherche au CNRS sur l’utilisation des SDHI dans l’agriculture. Ces molécules au mode d’action très particulier (elles bloquent la respiration cellulaire), utilisées aussi bien comme fongicide qu’insecticide, pourraient être à l’origine de développement de neuropathies ou de cancers. Les inquiétudes sont aussi grandes sur les conséquences à venir de « l’effet cocktail », ou l’ingestion d’une multitude de produits chimiques qui, seuls et à petite dose, ne constitueraient pas en soi un danger, mais réunis dans l’organisme pourraient faire un carnage. Les premières études sur le sujet n’en sont qu’à leur balbutiements.
L’utilisation en excès de produits, a priori naturels, à des fins industrielles et commerciales pose aussi problème. C’est ce qu’a relevé depuis longtemps l’épidémiologiste Pierre Meneton avec le sel et les problèmes cardio-vasculaires. Son parcours mérite que l’on s’y arrête un peu. Alors qu’il participe aux travaux de l’INSERM et des agences sanitaires françaises au début des années 2000 (AFSSA, puis ANSES), il signe une contribution à un rapport sur les effets de l’excès de sel dans l’alimentation. Il est immédiatement trainé dans la boue par les lobbies, attaqué devant la justice d’où il ne sortira blanchi qu’en 2008. Il découvrira même avoir été mis sur écoute en 2002. Cela révèle aussi l’inertie des politiques publiques : l’OMS préconise de diviser par deux la consommation de sel depuis le début des années 1980 ! Les autorités françaises feront confiance à « l’engagement volontaire » des industriels et professionnels de l’agro-alimentaire. Résultat, après 4 décennies le taux de sel dans notre alimentation n’a pas baissé significativement. Beaucoup trouveraient leur compte dans les excès de sel : un tiers de la consommation journalière de boissons en France serait due aux ajouts de sel dans les produits alimentaires.
Sur les plans écologiques et environnementaux, il est clair que la spécialisation et l’augmentation de la taille des exploitations agricoles, en particulier les élevages, induits par le modèle économique actuel accroit la consommation d’intrants, comme l’expliquent Natacha Sautereau et Marc Benoit, agroéconomistes à l’ITAB et l’INRA. Rappelons que le secteur de l’alimentation est responsable d’un quart des émissions de gaz à effet en France. L’industrialisation de la production alimentaire induit quasi mécaniquement une uniformisation de la production agricole : fruits et légumes calibrés en taille et/ou couleur en sont l’exemple : pour remplir cet objectif une pomme devra subir plus de 30 traitements, dont un bon nombre seulement pour garantir son aspect …
Évidemment, les premières solutions avancées par les différents intervenants tournent autour de la recherche publique, pour renforcer son indépendance et ses moyens d’interventions. Les budgets, on ne le répètera jamais assez, sont notoirement insuffisants. Seulement un dixième des dossiers présentés aux différents appels à projets ANR (Agence Nationale de la Recherche) qui ouvrent la porte à des financements sont finalement acceptés, alors qu’il n’y a pas 90 % des projets de recherches qui sont à jeter définitivement ! Il nous faudrait renforcer les coopérations entre instituts de recherche, comme le demande fortement Bruno le Bizec, du LABERCA et de l’école vétérinaire de Nantes, pour décloisonner les disciplines et donner un poids et une assise plus importante aux débouchés de ces travaux.
Sur les politiques tarifaires, plutôt que les taxes sur les produits de mauvaise qualité qui impactent comme souvent les classes populaires, une solution est à trouver dans les mécanismes qui valorisent les produits sains et les productions vertueuses, par des subventions, des chèques alimentations distribués aux ménages modestes ou en rémunérant les externalités positives.
Il faudra aussi renforcer l’information des individus pour orienter leurs actes d’achats : le Nutri-score ici semble s’imposer, mais il faudra aussi réfléchir au campagnes de communications comme de véritables outils de contre-marketing pour cibler les populations les plus vulnérables, dont bien sûr les ménages défavorisés, et séparer désormais la notion de mangeur de celle de consommateur. L’information passe également par l’instauration d’une base de données transparente, exhaustive et ouverte à tous, mangeurs comme chercheurs, alors qu’aujourd’hui les firmes ont du mal partager les leurs avec des organismes tels que l’OQALI que sous condition d’anonymisation de celles-ci.
Enfin, si aucun mécanisme d’incitation ne suffit à faire changer aux industriels la composition de leurs produits, il nous faudra apprendre à manier le bâton, ou en tout cas la menace du bâton en s’appuyant sur l’exemple du Royaume-Uni : l’État a pris les choses en main pour sortir de l’illusion des engagements volontaires pour un cadre législatif plus directifs pour les industriels et enfin efficace pour protéger la santé de la population.